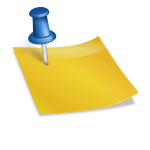Il est difficile d’imaginer que certaines races de chiens qui étaient autrefois immensément populaires n’existent plus de nos jours. Alors que quelques races sont restées pratiquement inchangées pendant des siècles, d’autres ont disparu complètement ou ont été croisées avec d’autres.
Découvrez ces dix races de chiens éteintes :
Table des matières
- 1. Clydesdale/Paisley Terrier
- 2. Braque du Puy
- 3. Chien tournebroche
- 4. L’épagneul de Norfolk/de Shropshire
- 5. Hare Indian Dog
- 6. Chien Poi de Hawaï
- 7. Chien d’ours tahltan
- 8. Retriever Jaune Russe
- 9. Chien courant du Sud
- 10. Mâtin des Alpes
- L’histoire de la race
- Article
- Quand le Troisième Reich préférait les animaux aux hommes
1. Clydesdale/Paisley Terrier
Ces jolis chiens originaires du Royaume-Uni étaient une version plus petite du Skye Terrier, une race qui existe encore mais qui est menacée d’extinction. Alors que les Skye Terrier était considérés des chiens de travail, les Paisley Terrier étaient des chiens de compagnie habitués au comfort des foyers aisés. Les célèbres Yorkshire Terrier – que vous connaissez sûrement- sont descendants de cette race désormais disparue.
2. Braque du Puy
Ces chiens d’origine française étaient admirés pour leur flexibilité et leur rapidité qui faisait d’eux de parfaits chiens de chasse. Les Braques du Puy furent créés en croisant d’autres races de braque avec des lévriers et furent fureur pendant le XIXè siècle avant de s’éteindre. Plusieurs races de braque plus agiles ont apparu ultérieurement.
3. Chien tournebroche
Ces boules de poils étaient considérées comme des chiens de cuisine. Cette race provenait du Royaume-Uni et sa seule tâche était de courir dans une roue pour que la viande tourne sur le feu. Pour garder leur motivation, on accrochait un morceau de viande crue devant eux. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé avec cette race, mais selon les experts ces chiens sont de la famille des actuels Terriers irlandais Glen of Imaal et des Welsh Corgis.
4. L’épagneul de Norfolk/de Shropshire
Cette race s’est éteinte au début du XXè siècle et est de la famille des Springers anglais. Ils furent croisés avec d’autres épagneuls car ils étaient considérés difficiles à éduquer. Les éleveurs ont pourtant essayé de conserver certaines caractéristiques propres à cette race, notamment leur extraordinaire facilité pour développer un lien avec leurs maîtres et leur habilité pour la chasse.
5. Hare Indian Dog
On ne sait pas exactement si ces canidés originaires du nord du Canada peuvent être considérés comme une race de chien, ou s’ils sont plutôt des hybrides entre le chien et le coyote. Dans tous les cas leur caractère et leur tempérament étaient propre aux chiens. Ils étaient utilisés pour chasser des lièvres mais avec le déclin des méthodes traditionnelles de chasse ces chiens ont été de moins en moins utilisés. Ils ont finalement disparus à cause des croisements réalisés avec d’autres races de la zone.
6. Chien Poi de Hawaï
Les familles à Hawaï avaient ces chiens pour plusieurs raisons. On les considérait comme des protecteurs spirituels des foyers (et spécialement des enfants). Malheureusement, quand les temps étaient difficiles on les gavait avec du Poi (un aliment typique hawaiien) pour les manger, d’où leur nom. Ces chiens avaient un fort caractère et étaient très protecteurs envers leur famille. Actuellement, malgré leur disparition, on utilise encore leur nom pour faire allusion aux chiens de race croisée et aux chiens errants.
7. Chien d’ours tahltan
Cette race était originaire du Canada et fut domestiquée par les habitants autochtones de la zone de Tahltan pour chasser des ours. Malgré leur petite taille, ces chiens étaient très puissants, ils chassaient en groupe et pouvaient distraire les ours pendant que les chasseurs approchaient. Cette race s’est malheureusement éteint et aucune race similaire existe de nos jours.
8. Retriever Jaune Russe
Cette race était très similaire aux Golden Retriever bien connus d’aujourd’hui, mais beaucoup plus grande (jusqu’à 76cm d’hauteur au niveau de l’épaule). Ces chiens étaient utilisés pour protéger les troupeaux ainsi que pour guider les personnes à travers les dangereuses montagnes du Caucase. On ne connait malheureusement pas les raisons de pour lesquelles la race s’est éteinte en début du XXè siècle.
9. Chien courant du Sud
Ce chien d’origine britannique est l’arrière grand-père du Beagle, une race adorée de nos jours. Ces chiens étaient connus pour leur voix profonde et euphonique ainsi que pour leur capacité à se servir de leur flair. On les utilisait normalement pour chasser des lièvres et des cerfs mais ils ont été progressivement croisés avec d’autres races car ils étaient trop lents et intègrent aujourd’hui la longe liste de races de chiens éteintes.
10. Mâtin des Alpes
Si au cours de l’histoire de la Terre, le phénomène de disparition des espèces est une donnée constante, la croissance du nombre d’humains au cours des 100 000 dernières années a irrémédiablement accentué le processus.
Sixième extinction massive depuis la naissance de l’univers, le phénomène, connu sous le nom d’extinction de l’Holocène, a connu une accélération sans précédent au cours du XIXe siècle, avec le développement de l’ère industrielle. La pollution, la surexploitation des ressources et la destruction des habitats ont eu et ont encore des effets désastreux sur la faune et la flore.
 Source : Roelant Savery – Edward’s Dodo
Source : Roelant Savery – Edward’s Dodo
Pendant près de 50 ans, le chien sauvage des Highlands de Nouvelle-Guinée a appartenu à ces espèces considérées comme éteintes par les scientifiques. En l’absence d’individus observés dans la nature ou en captivité, l’animal avait, semble-t-il, connu le même sort que bon nombre avant lui. Race de chien la plus rare du monde, le chien sauvage des Highlands Nouvelle-Guinée est également considérée comme la plus ancienne.
En 2016, une expédition menée par le biologiste James K McIntyre, membre du groupe New Guinea Highland Wild Dog Foundation (NGHWDF), s’est lancée sur les traces de ce canidé élusif et secret. Épaulé par des chercheurs de l’université de Papouasie, en Indonésie, le scientifique a fait, en septembre 2016, une découverte capitale : une empreinte de patte.
Forte de cette nouvelle information, l’équipe a alors disposé de nombreuses caméras de surveillance, qui ont fini par livrer leurs secrets. En seulement deux jours, 140 images du chien sauvage des Highlands de Nouvelle-Guinée ont ainsi pu être capturées, au sommet du mont Puncak Jaya. Une quinzaine d’individus vivent ainsi dans cette zone difficile d’accès et impropre à l’habitat humain.
 Source : NGHWDF
Source : NGHWDF
Si des signalements existaient depuis 2005, ils n’avaient jamais été pris au sérieux par les scientifiques. Désormais, la présence du chien est formellement attestée. Des analyses ADN d’excréments ont confirmé la parenté lointaine du chien des Highlands de Nouvelle-Guinée avec le chien chanteur de Nouvelle-Guinée et le dingo australien.
Le NGHWDF explique :
Bien que la taxonomie et les relations phylogénétiques avec les races apparentées et les dingos australiens sont pour le moment controversées et soumises à un examen à la fois pour les chiens chanteurs et les chiens des Highlands de Nouvelle-Guinée, l’importance historique et scientifique du chien des Highlands demeure critique dans la compréhension de l’évolution canine, de la co-évolution humaine et canine, et des migrations, ainsi que dans la compréhension de l’écologie et l’implantation humaines, dérivée de l’étude des chiens et de l’évolution de ces derniers.

Source : NGHWDF
La « redécouverte » du chien sauvage peut redonner espoir pour d’autres espèces présumées disparues. En mars 2017, une équipe de scientifiques de l’université de James Cook, en Australie, a installé un dispositif de vidéo-surveillance sur la péninsule du cap York, dans la région du Queensland. Son but ? Retrouver des traces du tigre de Tasmanie, éteint depuis 1936. Connu également sous le nom de thylacine, le tigre de Tasmanie était un grand marsupial carnivore. Chassé par les colons, puis victime d’une campagne d’extermination systématique à partir des années 1830, le thylacine aura disparu de la surface de la Terre en tout juste cent ans.
 Source : Wikipedia
Source : Wikipedia
Pourtant, des témoignages récurrents attestent de sa présence sur le territoire australien. Si de nombreux canulars sont également à noter, certains signalements demeurent probants.
D’après la chercheuse Sandra Abell, même en l’absence de thylacine, ces caméras permettront sans aucun doute d’en apprendre plus sur des espèces peu connues et de mettre tout en oeuvre pour les protéger, afin de ne pas répéter les erreurs du passé.
Via : Science Alert
* * *
Chez Holidog, nous voulons améliorer la vie de nos compagnons : nous vous permettons de le laisser en famille d’accueil pendant vos voyages (testez la garde), de le combler avec une box chaque mois (une box offerte ici) et de lui donner le meilleur avec notre nouveau service d’alimentation ultra-premium livré en 1h (découvrez nos repas pour chien et chat). Merci de nous faire confiance !
Qu’y-a-t-il de commun entre un dogue allemand et un minuscule chihuahua (photo) ? Entre un chat de gouttière et un splendide savannah ? A priori rien, vu leurs physiques ; et pourtant ils appartiennent les uns et les autres à la même espèce. Ce qui les différencie, c’est leur race. Des origines à nos jours, le chien et le chat en ont connu bien des évolutions. Il y a longtemps que nos bons matous d’appartement ne chassent plus les souris, sauf pour leur plaisir. Les chiens, créés au départ pour la chasse et la garde des troupeaux (certains jouent encore ce rôle), sont devenus, pour la plupart, des animaux de compagnie. Si les critères de sélection pour la création de races de chiens furent avant tout économiques, ceux pris en compte pour les chats sont purement esthétiques. Alors dans quel but créer toujours plus de races ?
Pour en comprendre l’intérêt, il est nécessaire de se plonger dans l’histoire des animaux. » Pour commencer, il faut bannir de son vocabulaire le mot fabrication qui sous- entend de sombres et mystérieuses manipulations génétiques » souligne le professeur Bernard Denis, zootechnicien. » L’apparition de nouvelles races date du 19ème siècle en Angleterre. Les éleveurs français ont suivi le mouvement. Et c’est à partir d’une maxime que ne renieraient ni les » locavores » d’aujourd’hui, ni monsieur de La Palisse (il est plus censé de marier les animaux d’une espèce donnée, présents dans une région donnée, qu’avec ceux de la région voisine), que l’aventure a commencé. » Bergers de Brie et de Beauce, braque d’Auvergne, épagneul breton, par leur nom, en sont des exemples vivants. Il s’agissait ensuite de repérer les sujets les plus caractéristiques qui devenaient les fondateurs de leur race. Avec inscription dans un livre généalogique.
Un dogue du Tibet pour 1,4 million d’euros
Plusieurs éleveurs se sont entendus pour définir ensuite un standard (description physique détaillée de ce qui devrait être le chien idéal). Il est arrivé qu’un seul éleveur ou qu’une personnalité, comme le pasteur Jack Russell pour le célèbre chien du même nom, joue un rôle important.
La mode des petits chiens ne date pas d’aujourd’hui. En l’an 1000 avant J.-C., en Chine, la cour impériale s’entiche du happa, une sorte de cavalier king charles avant l’heure. Connu au temps de Ramsès II, le bichon maltais a conquis la Grèce antique et Rome, avant de séduire les cours royales européennes, Marie Stuart ou Madame de Pompadour en étaient fans. Les petits chiens font même office de bouillotte sur les pieds et les mains de ces dames. Une ancienne superstition leur attribuait des pouvoirs de guérison : la chaleur de leur corps avait, paraît-il, des effets apaisants en cas de douleurs articulaires, de problèmes digestifs, d’anxiété ou de névroses. Ainsi les gants et les châles en poil de bichon maltais furent très en vogue en Angleterre à partir du XVe siècle.
Aujourd’hui, chiens et chats font la Une des journaux pour de tout autres exploits. Comme ces matous perdus qui parcourent des centaines de kilomètres pour retrouver leur foyer ou ce dogue du Tibet, cédé à un homme d’affaires chinois, pour 1,4 million d’euros !
» Pour définir une race, on peut se référer aux critères de la Fédération cynologique internationale. Pour être reconnue comme race par la FCI, il faut au minimum 8 lignées. L’éleveur doit produire entre 800 et 1000 chiens ! Chiffres tout à fait discutables. Face aux demandes (deux à trois par an), la FCI refuse de plus en plus de reconnaître de nouvelles races. Beaucoup de chiens, assez proches les uns des autres, mériteraient plutôt d’être reconnus comme variété. Critères qui n’ont pourtant rien d’absolu, précise le professeur Denis. En France, via la Société centrale canine, les chiens sont inscrits au LOF, le livre des Origines français, et on leur délivre un pedigree. «
Le mythe du chat sauvage
Les chats ont aussi leur fédération, le LOOF (le Livre officiel des origines félines), qui ne concerne que la France (la législation en matière d’élevage est différente aux États Unis par exemple). » Le chat n’étant pas un animal utilitaire, seuls des critères esthétiques président à la création d’une nouvelle race, explique Catherine Bastide juge félin. Aujourd’hui, il existe une soixantaine de races, les chiffres varient selon les associations, dont la moitié datent de moins de 50 ans. La création d’une nouvelle race n’est pas toujours bien encadrée, en particulier à l’étranger. Ces dernières années sont apparues des variétés plus que bizarroïdes, avec un poil frisé, des oreilles repliées vers l’avant ou l’arrière, nues ou sans queue. La France a un principe : pour qu’une nouvelle race soit reconnue, elle ne doit pas mettre en péril la santé ou le confort de l’animal. »
Malgré tout, un nouveau phantasme est apparu depuis quelque temps : croiser chat domestique et chat sauvage. Une union contre-nature. La réglementation est stricte : tous les animaux issus d’hybridation sont considérés comme sauvages jusqu’à la quatrième génération. La cinquième devient domestique, à condition de justifier d’une filiation au LOOF. La production est minime. Pour preuve, seules cinq portées de savannah et quatre de chausie (un croisement d’abyssin et de chaus, chat sauvage) ont été déclarées au LOOF par le même éleveur. Là aussi, la production est souvent motivée pour des raisons financières. Mais comme le souligne Catherine Bastide, » fort heureusement, pour qu’une race puisse s’établir, elle doit répondre à de nombreux critères, en particulier celui de rencontrer un public assez large. Une fois l’effet de mode passé, les races trop excentriques s’éteignent d’elles-mêmes. «
Choisir un animal de compagnie de race permet de s’assurer de son caractère et d’une morphologie bien précise : lévriers athlétiques et endurants, golden retrievers, obéissants et faciles à éduquer, sacrés de Birmanie pacifiques et amicaux, siamois complexes et lunatiques, etc.
Mais rien n’empêche de leur préférer un corniaud ou un chat des rues, fruit de l’amour et du hasard. Un exemplaire unique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !
Les Français et leurs chiens préférés
Nouvelles races de chiens : en France et dans le monde
» La génétique c’est un rasoir placé dans les mains d’un singe » Avec cette formule, Alain Varlet, directeur des relations extérieures à la SCC prévient d’emblée. Pour créer une race, il faut une population géographique existante, qui a eu une histoire, et surtout il faut avoir le sens de l’élevage pour la stabiliser. D’où l’importance des éleveurs. Pour reconnaître une race, la FCI exige 8 lignées indépendantes, au sein desquelles il faut deux mâles et six femelles qui ne soient pas frères et sœurs.
Au niveau français, la SCC a reconnu en 2003 l’épagneul de Sainte-Usuge (petit épagneul de Bresse) et le cursinu (chien primitif de Corse), deux races existant au XVIe siècle et quasi disparues à la fin des années 40 ; le briquet de Provence (petit chien de chasse) a gagné ses galons en 2008. D’autres, bergers de la Crau (chien de transhumance), de Savoie, du Languedoc sont en cours de reconnaissance. Ailleurs dans le monde, il faut s’attendre à voir de nouvelles races émerger dans des pays comme l’Inde, le Brésil et la Chine. » Aux Etats-Unis, ils ont créé le labradoodle, issu d’un croisement labrador-caniche. Il ressemble étrangement au chien d’eau portugais que nous connaissons bien ici, » souligne André Varlet (propos recueillis par Michel Sauzon.)
L’histoire de la race
En 1878 des éleveurs allemands décident de faire une première tentative de regroupement pour l’amélioration de la race du berger allemand. Ils décident alors de créer une race morphologiquement homogène.
C’est alors que depuis 1910, l’importation de ces chiens en France n’a cessé d’augmenter.
L’AS pourrait descendre de Hektor Linksrhein, rebaptisé par la suite Horand von Grafath, qui était de couleur grise à poil mis long.

Horand von Grafath
Notons que le grand père de ce chien, Greif, était blanc, il serait l’origine du Berger Allemand (beauté, travail, poil long), du Berger Blanc Suisse et de l’AS.
Certaines lignées de l’AS nous viennent tout droit de l’Allemagne de l’Est (lignées DDR). Pour mieux les comprendre, il faut retourner à l’époque de la Seconde Guerre Mondiale, dont 200.000 Bergers Allemands furent sur le front et beaucoup moururent durant les batailles. A cette période, en Allemagne de l’Ouest, Hitler sélectionnait un type différent de Berger Allemand essentiellement noir et feu, et plus fin que ceux d’Allemagne de l’Est.
Le voici en photo ci-dessous avec une de ses chienne Blondie (type très fin, poil court).
Blondie
De 1949 à 1961 beaucoup d’Allemands de l’Est migrèrent vers l’Ouest, c’est alors que les autorités décidèrent de construire un mur pour séparer les deux Berlin. C’est alors le début de la Guerre Froide qui fût l’un des plus gros impacts sur la race car elle a entraîné 40 ans » d’élevage fermé « , de 1949 à 1989.
Le gouvernement de l’Allemagne de l’Est prit la décision de règlementer l’élevage de façon stricte pour les Bergers Allemands. Il en décida de contrôler la sélection, les inscriptions, l’élevage avec des directives de reproduction très sévères.
Les normes de sélection militaires voulaient des chiens puissants, trapus, vifs, vigilants, courageux, loyaux, sûrs d’eux et dotés d’une grande intelligence !
Leur santé devait être sans faille. Lorsque que celle-ci était douteuse, les chiens étaient retirés de la reproduction. Ces normes incluaient également l’aptitude au travail, par l’endurance, la ténacité, la capacité d’escalade sur des murs droits, la robustesse et le flair pour la recherche.
Ces chiens étaient exposés à un climat très rude et à des conditions physiques extrêmes pour génétiquement sélectionner les chiens les plus résistants aux maladies.
Chaque portée était vérifiée minutieusement (dents, oreilles, robe, tempérament) digne de l’inspection d’une pièce militaire…
Ces chiens étaient de couleur sombre avec une pigmentation foncée ainsi qu’une forte ossature.
Cette dure réglementation créa le chien de berger DDR, dont environ 1000 d’entre eux furent utilisés en garde frontière.
Après la chute du mur de Berlin, dans les années 1990, les patrouilles n’ayant plus à garder les frontières se débarrassèrent de ces chiens, en les vendant, les abandonnant ou même en les euthanasiant. Quelques années après, le monde entier s’est intéressé à cette race de chien, et très peu d’éleveurs gardèrent ces lignées et cette sélection.
La grande différence avec l’Allemagne de l’Ouest, est qu’ils se sont plus orientés à sélectionner un chien de beauté (couleur noir et feu, dos en pente, angulations plus prononcées, gabarit fin). Cette race ayant fait preuve de nombreuses qualités fut très demandée dans le monde entier.
C’est ainsi que pour satisfaire les demandes en chien, les éleveurs firent subir à la race un pourcentage de consanguinité plus élevé, responsable de l’apparition de chiens moins robustes, laissant leur caractère de côté. On vit donc apparaître des changements physiques (chiens plus petits, plus fins, au dos vouté etc.) …
Aujourd’hui, un des nombreux buts de l’UCFAS est de continuer à sélectionner des chiens sains, rustiques, en bonne santé, équilibrés, à fort tempérament, intelligents, vifs mais aussi affectueux, protecteurs et très proches de leur maître.
Il aura fallu près de 9 mois à l’archiviste Richard Schneider pour numériser la collection intime de photographies d’Hitler prises par le photographe attitré du » Führer « , Heinrich Hoffman.
Au total ce ne sont pas moins de 1270 photos d’archives qui ont pur être numérisées par l’archiviste sur un total de 41 000 négatifs. » La plupart de ces clichés n’ont probablement jamais été vus aussi clairement » explique Richard Schneider qui a réalisé un travail d’orfèvre. « Ce qui rend ce projet de numérisation spécial, c’est que l’image suivante a été reproduite à partir du négatif original, plutôt que d’être une copie ou une copie d’une copie, cela se traduit par une qualité inégalée » peut-on lire dans un article du Washington Post. Le travail de numérisation de ces photographies a été très technique car à l’époque le photographe nazi, Heinrich Hoffman, travaillait avec des négatifs sur des plaques de verre. Avec le temps, beaucoup de ces négatifs ont été brisés en plusieurs morceaux, ce qui a valu à l’archiviste un long travail de puzzle: « c’était un peu effrayant, comme si je pouvais l’entendre dire: » Danke de m’avoir rétabli. Chaque fois que je tombais sur une photo de lui en train de me regarder, cela me faisait frissonner. »
Les photos devraient bientôt être rendues disponibles en ligne explique Billy Wade, archiviste chargé de la supervision du projet.
Imaginez un lundi après-midi superbe, l’été indien qui baigne la France et en éclaire le centre d’une lumière vive et chaude. Vous admirez cette magnifique campagne qui conduit de Limoges à Oradour-sur-Glane. Tout Français connaît ou est censé connaître Oradour, érigé dès 1944 en épitomé du martyre de la France occupée, violentée par la barbarie nazie. Le Gouvernement provisoire de la République française, par la voix de son chef, le général De Gaulle, a fait d’Oradour un mémorial à ciel ouvert: chaque maison martyrisée témoigne à jamais de la tornade de violence qui s’est abattue sur ce bourg paisible, le 10 juin 1944.
Ce samedi-là, le régiment Der Führer, de la division de Waffen SS Das Reich, encercle les lieux, rassemble la population sur la place principale. Les hommes sont entraînés dans des granges et dans le garage automobile de la ville, et mitraillés. Les femmes et les enfants descendent vers la belle église du XVe siècle qui marque l’entrée du bourg. Ils y sont enfermés, asphyxiés, mitraillés, brûlés : 207 enfants, du nourrisson à l’adolescent, périssent. Une femme parvient à s’échapper par une ouverture. Une autre la suit, avec son bébé dans les bras. Le bébé crie, un SS abat l’enfant et sa mère. L’autre femme, blessée par balles, se terre et survit. En moins de deux heures, les hommes de la Das Reich ont assassiné 642 personnes.
Ces hommes sont des tueurs, non des soldats. Ils ont plus massacré de civils qu’affronté de soldats ennemis. La division SS a combattu sur le front de l’Est, dans cette « ex-URSS », disaient les nazis, où non pas un, non pas dix, cent ou mille, mais cinq mille Oradour-sur-Glane ont été perpétrés. Le pain quotidien de ces hommes-là, c’est de mitrailler les hommes, et de brûler les femmes et les enfants dans des granges ou dans des églises en bois – et de piller, de boire, de festoyer. Christian Ingrao a brossé un portrait saisissant de ces reîtres assassins dans les Chasseurs noirs, qui traite d’une autre unité SS, mais qui décrit bien comment un être humain devient un chien de l’enfer. Michaël Prazan a fait un film remarquable sur les assassins d’Oradour. Quant à Henry Rousso, il a, dans le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours,montré comment la blessure d’Oradour, qui devait cicatriser le tissu français dans un deuil commun, a rouvert la plaie lors du procès de Bordeaux en 1953.
Vous voyez ce que je fais? Je cite des collègues, leurs travaux, et cette intelligence qu’ils apportent à l’événement. C’est ce que j’ai fait tout de suite, cet après-midi-là: j’ai compté mes billes, je me suis agrippé à mes collègues et à mes amis, à leurs livres, comme à des bouées. Parce que, Oradour, on peut s’y noyer, dans les larmes et dans les cris. Les citoyens du bourg vaquaient, ils jouissaient d’un début d’été d’autant plus beau que quelques jours auparavant, le 6 juin, la Normandie était devenue la tête de pont de la liberté. Mais ils se trouvaient sur la route d’une bande de tueurs.
Dans cette région de résistance, où les incidents se multipliaient pour ralentir les renforts allemands en route vers le front, la Das Reich suit une procédure éprouvée à l’Est: en cas d’attaque de « terroristes » ou de « partisans », le lieu de vie le plus proche doit être détruit – pour assécher la logistique des résistants, exprimer sa rage, rassurer les hommes (qui, dans un monde qui s’effondre, ont au moins encore le pouvoir de tuer) et semer la terreur. Ce fut donc Oradour, dont chaque maison, à deux exceptions, fut détruite. Oradour, ce Pompéi du XXe siècle, victime d’une violence extrême – celle des hommes et non pas celle d’un volcan.
Ce qui vous saisit sur les lieux est indescriptible: le quotidien d’une douce banalité vitrifié par les tueurs aux « yeux pleins d’Arès ». On éprouve une horreur sacrée devant ces ruines, ces carcasses d’automobiles, ces machines à coudre. 207 enfants. Ecoutons cette journaliste de l’Humanité qui couvre le procès de 1953 : « Je croyais tout savoir d’Oradour . Et puis hier, pendant qu’une maman disait ce que fut pour elle l’après-midi du 10 juin 1944, j’ai compris que ce que j’avais pu imaginer jusqu’ici était dérisoirement hors de mesure avec l’immensité du drame. Mme Demery est une femme petite et simple, toute vêtue de noir, qui se raidit devant le micro, essaie de ravaler ses sanglots, puis réussit à murmurer comme une excuse : « Pardonnez-moi, M. le Président, j’en ai perdu treize de ma famille. » Je regarde cette femme en deuil. Je pense à la double rangée de petits marchant vers l’église. Les siens avaient 4 et 6 ans. Ils étaient encore à la « petite école », nous dit-elle. Je les imagine avec deux cents autres en train de trottiner. »
On fait donc de l’histoire: on dégage les enjeux militaires, idéologiques, anthropologiques de l’événement. Puis son histoire politique, judiciaire et mémorielle après 1944. On se recompose, on réfléchit, on lit des livres, on réintègre un univers humain. On se rassure. Cela sert aussi à ça, l’histoire.
Cette chronique est assurée en alternance par Serge Gruzinski, Sophie Wahnich, Johann Chapoutot et Laure Murat.
Johann Chapoutot
Une unité très violente
Auprès de ses hommes Dirlewanger jouit d’un grand prestige, surtout au début et auprès des chasseurs. Son charisme de chef de bande est moins net au retour de Biélorussie : la bataille dans Varsovie ne correspond plus au « savoir faire » de l’unité et le chef n’économise plus ses hommes ou est dépassé par ce type de combat dans « la jungle urbaine ». Par les « vrais » SS, Dirlewanger est jugé diversement, certains se plaignent auprès de la hiérarchie : il ne correspond pas bien à l’idéal-type enseigné aux SS dans leurs centres de formation. Il se moque complètement du droit (alors que beaucoup de SS étaient recrutés parmi les juristes !) L’action violente a d’abord été exercée contre des prisonniers en Pologne. Mais Christian Intrao accorde une place essentielle aux actions en Biélorussie (février 1942-juillet 1944) à la fois en raison de la documentation et de l’importance des faits. La brigade Dirlewanger opère contre les partisans russes, qui vont être de plus en plus coriaces, contre les villageois qui les soutiennent réellement ou pas, et contre les Juifs qui sont exterminés sur place. La violence exercée sur les Juifs n’est pas particulièrement montrée dans cet essai. Par contre, la violence exercée sur les villageois biélorusses est davantage précisée : c’est une longue série d’Oradour-sur-Glane. Par ailleurs, les viols collectifs et les pillages (planifiés autant que spontanés) semblent devenir une activité routinière de l’unité. Aussi, surtout après l’épisode de Varsovie, personne ne souhaite la voir arriver sur son territoire. La brigade Dirlewanger —et les unités allemandes qui l’entourent— rivalise de barbarie avec les troupes soviétiques.
De la métaphore de la chasse à l’analyse du nazisme
C’est le plus original dans l’ouvrage de Ch. Ingrao. L’histoire, au sens classique, s’enrichit ici de la réflexion de Bertrand Hell (Le Sang noir. Chasse et mythe du sauvage en Europe, Paris, Flammarion, 1994.). “L’image du chasseur, écrit Christophe Ingrao, tout comme celle des différents gibiers, répond ainsi à un imaginaire européen du Sang noir qui définit la ‘juste distance’ au Sauvage de ces sociétés et, par des discours interprétant les comportements des chasseurs, les insère dans l’organisation sociale, y acclimate la sauvagerie et la violence qu’elle induit.” Il poursuit en notant que “ce cadre interprétatif anthropologique” est “appliqué cette fois à une société nazie dont on sait par ailleurs la sensibilité aux discours idéologiques liés au sang.” (p. 15-16) Dans le chapitre Une guerre cynégétique? sont ainsi explorées plusieurs régimes de chasse.
D’un côté, donc, des affûts en petits groupes, à la recherche de l’identification, de l’évaluation de l’ennemi. Guerre proche, au fond, de cette « Pirsch » que pratiquent les chasseurs individuellement, et qui consiste à pister et tracer le cerf, à l’identifier, et à lire dans le sol et la végétation dans ses traces et ses fumées, sa stature, son genre et son âge avant de le tirer d’un seul coup de fusil, en face à face au plus près. Chasse élitiste s’il en est, la « Pirsch » se goûte d’après les dires des chasseurs, autant dans la piste de l’animal et dans l’évaluation exacte de la proie que dans l’ultime face-à-face avec le gibier. Cette forme de chasse avait la faveur de Himmier, de Pohl, de Berger, et de tous les dignitaires qui avaient participé au processus de création de l’unité : les autorisations de chasser édictées par Himmier mentionnaient toujours une seule prise, et elle étaient très précises quant à l’âge et au genre de la bête à tirer.
D’un autre côté, les grandes opérations de ratissage sont en miroir, l’équivalent de la chasse à la battue. Celle-ci consiste, en bouleversant le milieu de vie des proies par du bruit, des coups et des incendies, à les obliger à fuir vers le cordon des tireurs. Les ratissages menés en Biélorussie fonctionnent exactement sur le même modèle. La première chasse, élitiste et individuelle, s’oppose à la Seconde, collective et égalitaire, mais bien plus meurtrière. Consciemment ou non, les Allemands avaient calqué leurs méthodes de lutte contre les partisans sur des savoir-faire immémoriaux.
Le livre de Christian Ingrao, auquel l’absence de carte est le seul reproche que je puisse faire, évoque bien d’autres horreurs. Mais le chapitre qui n’est pas le moins surprenant est à mes yeux le dernier, celui qui envisage l’après-guerre. Oskar Dirlewanger a été fait prisonnier et est mort torturé sans doute le 7 juin 1945. Les tribunaux allemands ont été assez faibles devant les survivants de l’unité. Les preuves matérielles, les témoignages précis sur les exactions ont trop souvent manqué. En même temps, la littérature s’est emparée de la légende noire, mais comment ? Le roman de Willi Berthold, Brigade Dirlewanger (Cologne, 1963), oublie de mentionner que “le grand réservoir des recrutements de l’unité avait été les prisons de la Wehrmacht et de la SS (…) Il s’agissait de montrer l’unité sous l’angle non d’un bataillon disciplinaire, mais bien comme un ramassis de marginaux. Ainsi se trouvait développée une première strate du discours sur la violence nazie. Celle-ci était le fait de criminels issus des bas-fonds de la société allemande d’avant guerre auxquels un régime lui même criminel avait laissé libre cours dans des espaces biens particuliers. Le fait que la violence nazie fût le fait des déclassés sociaux entrait en résonance avec l’une des thèses centrales des historiens. Il s’agissait bien de tracer une sorte de cordon sanitaire entre une société allemande dont la normalité n’aurait pas été entamée par les douze années de régime nazi et une poignée de marginaux, en l’occurrence criminels, qui auraient pris en charge les crimes monstrueux dont le régime s’était rendu coupable.” Enfin n’oublions pas que dix-neuf survivants de cette unité participèrent aux débuts de la STASI.
L’ouvrage de Christian Ingrao est du nombre de ceux qui permettent de bien saisir la violence du nazisme sur les populations, et peut-être ajoute-t-il même quelque chose de neuf aux Origines intellectuelles du nazisme selon l’illustre George L. Mosse.
• Christian INGRAO – Les chasseurs noirs. La brigade Dirlewanger
Perrin, 2006, 292 pages. ISBN 2.262.02424.3.
Figure centrale des Bienveillantes, le best-seller de Jonathan Littell (Gallimard), le bourreau hante les travaux sur la guerre depuis une quinzaine d’années. Quand Lawrence Keeley relate les massacres des sociétés primitives (1), quand Denis Crouzet évoque les atrocités commises au XVIe siècle par les « guerriers de Dieu » (2), quand Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker décrivent les violences perpétrées sur les champs de bataille de la Grande Guerre (3), quand Christopher Browning raconte comment cinq cents « hommes ordinaires » ont participé à l’extermination de 80 000 juifs polonais en seize mois (4), quand le journaliste Jean Hatzfeld au Rwanda (5) ou le cinéaste Rithy Panh au Cambodge (6) interrogent d’anciens bourreaux, c’est chaque fois pour tenter de répondre à la même question : pourquoi la guerre transforme-t-elle tant d’hommes en brutes sanguinaires ?
Les « chasseurs noirs » dont Christian Ingrao raconte la macabre épopée n’étaient pas destinés à accomplir les basses oeuvres du Troisième Reich. Petits délinquants, marginaux ou opposants politiques enfermés dans des camps de concentration, soldats condamnés pour indiscipline, ils n’avaient guère de raisons de servir le régime. Pourtant, quand ils furent incorporés à la brigade Dirlewanger, une unité SS créée en 1940 pour combattre les partisans opérant derrière les lignes allemandes sur le front de l’Est, ils semèrent une véritable terreur, incendiant des villages, violant et pillant sans relâche. En quatre ans, ces quelques centaines d’hommes tuèrent plus de 60 000 personnes – la moitié en Biélorussie -, dont une forte proportion de femmes et d’enfants. Pourquoi ?
Pour Christian Ingrao, l’explication par la « contrainte » ne tient pas, sauf peut-être dans les derniers mois, quand l’augmentation du nombre d’insoumis entraîna un durcissement de la discipline. Au total, rares furent ceux qui rechignèrent à commettre des atrocités. Des témoignages décrivent au contraire leur « courage insensé », la « possession qui les habit(ait) au moment de charger ». Cherchant à percer le mystère de leur « consentement », l’historien évoque d’abord le « magnétisme » exercé par Oskar Dirlewanger, le chef de l’unité.
« DOMINATION CHARISMATIQUE »
Protégé par Himmler, le chef de la SS, ce nazi fanatique au casier judiciaire chargé (malversations, voies de fait, pédophilie) n’était pas seulement un soudard intrépide. Il tenait aussi à accompagner ses hommes dans leurs beuveries, profitant de ces moments de complicité virile pour asseoir sa « domination charismatique » et renforcer la cohésion interne de l’unité. Entre la troupe et ses chefs se tissa ainsi une sorte de « relation contractuelle » : « Les hommes consentaient à partir en opération contre un ennemi qu’ils méprisaient et haïssaient, à charge pour les officiers de leur garantir sécurité physique relative, souplesse disciplinaire au quotidien et confort minimal. »
La haine et le mépris de l’ennemi : c’est là l’autre élément qui permet d’expliquer la « violence paroxystique » déployée par ces combattants. L’examen de leurs techniques criminelles montre en effet qu’ils considéraient leurs victimes comme de simples animaux, les traquant selon des règles analogues à celles de la chasse à l’affût ou à la battue. Ceux qui n’étaient pas directement tués étaient traités comme du « bétail domestiqué » : fouettés, brûlés à coups de cigarettes, ils étaient ensuite pendus ou exposés comme des trophées de chasse. Certains furent même enterrés dans des cimetières animaliers.
Face à de telles horreurs, il peut être rassurant de rappeler que Dirlewanger recruta à l’origine des hommes condamnés pour braconnage, comme si leurs compétences les prédestinaient à devenir de bons « chasseurs d’hommes ». Rassurant mais faux : non seulement les braconniers furent minoritaires au sein de l’unité, mais ceux qui n’avaient pas leur expérience commirent les mêmes crimes. « Consciemment ou non, les Allemands avaient calqué leurs méthodes de lutte contre les partisans sur des savoir-faire immémoriaux », des « codes anthropologiques anciens, communs aux cultures européennes depuis l’âge préhistorique », analyse Christian Ingrao. Telle est la leçon de ce livre terrible, passionnant parce qu’infiniment dérangeant.
LES CHASSEURS NOIRS. La brigade Dirlewanger de Christian Ingrao. Perrin, 292 p., 20,50 €.
(1) Les Guerres préhistoriques, éd. du Rocher, 2002.
(2) Les Guerriers de Dieu, Champ Vallon, 1990, réed. 2005.
(3) 14-18. Retrouver la guerre, Gallimard, 2000, réed. « Folio », 2003.
(4) Des hommes ordinaires, Les Belles Lettres, 1994, réed. 2005.
(5) Une saison de machettes, Seuil, 2003.
(6) S21, la machine de mort khmère rouge, sorti en salles en 2004.
Thomas Wieder
- Partage
- Partager sur Facebook Partager sur Facebook
- Envoyer par e-mail Envoyer par e-mail
- Partager sur Messenger Partager sur Messenger
- Partager sur Whatsapp Partager sur Whatsapp
- Plus d’options Plus d’options
- Plus d’options
- Copier le lien
Article
23Manipulant la langue, ou l’ignorant, L. Ferry fournit au lecteur de ses traductions une mise en page bien calculée, en particulier pour les notes ajoutées en bas de page dans sa traduction de l’introduction (1994, pp. 508-512). Ces références au Journal officiel allemand sont en fait tirées du texte traduit, elles remplacent, en bas de page, les références bibliographiques données par le texte allemand, si bien que certains lecteurs, certes un peu naïfs, pourraient les prendre pour les propres recherches de L. Ferry. Plus nettement théâtrale est la mise en vedette de la signature d’Hitler auprès de la loi du 24/11/1933. Dans son ouvrage, L. Ferry la dispose sous un extrait d’un commentaire de Giese, intitulé à tort: Article 1 de la loi du 24 novembre 1993.
24Cette signature est une banalité juridique depuis le 31 janvier 1933, que le Führer partage rarement avec Hindenburg, dont par exemple, la loi sur la protection de la santé publique (22/4/1933). Cette mise en scène d’une évidence juridique par L. Ferry, vise évidemment à souder un nom d’horrible mémoire à un texte. Il est à peine croyable que pareille supercherie ait pu impressionner des lecteurs, mais c’est pourtant vrai, comme en témoigne le texte de Djénane Kareh Tager qui, dans l’Actualité religieuse (15/7/1996, p. 24) écrit: “l’exergue de la loi est signée Adolphe Hitler”: le terme exergue, étranger au vocabulaire juridique, montre la passage du domaine de la réalité juridique à celui de l’imaginaire propre au mythe. Cette mise en scène du nom d’Hitler entre dans la démonstration du prétendu rôle personnel d’Hitler dans l’élaboration de la loi du 24/3/1933. Pour ce faire, L. Ferry s’appuie exclusivement sur le texte donné par Krebs comme “instruction de notre Führer”: “dans le nouveau Reich, il ne doit plus y avoir la moindre place pour la cruauté envers les animaux”. Partant de cette déclaration d’un dignitaire mis en place pour “nazifier” la protection animale, c’est-à-dire partant de la propagande nazie, Ferry attribue à Hitler le rôle de père concepteur, de moteur et de seul initiateur d’une loi de protection animale. De texte en texte, cette affirmation évolue jusqu’à la certitude absolue ; qu’on en juge: que cette loi serait issue de “sa volonté personnelle”, “Hitler en fait son affaire.”, (la volonté d’éviter la cruauté envers les animaux, … volonté chère au cœur d’Hitler lui-même”. “Hitler tiendra à suivre personnellement l’élaboration de cette gigantesque loi (180) pages”. F. Reynaert renforce le vocabulaire, mais non la source informative, en écrivant dans le Nouvel Observateur que le Führer l’a “exigée” (N° 1460, 1992, p. 18). Dans sa thèse de droit soutenue à l’Université de Nantes (2 avril 1999, Evolution de la réglementation de protection des élevages en Europe) Martine Leguiller-Balloy va jusqu’à écrire : “Ne faudrait-il pas se remémorer que Hitler fut le plus grand protagoniste de la législation animale de notre siècle”. De plus, L. Ferry, (1992, p. 182) affirme que les lois, animal-chasse- nature sont “toutes trois commandées par Hitler, qui en faisait une affaire personnelle”. Or ces lois sont depuis longtemps bien documentées. Pour celle du 24/11/1933, on a constaté que c’est Göring qui lance l’affaire de l’expérimentation animale. Pour la loi sur la chasse, L. Ferry avance une contre-vérité flagrante, puisque, dès l’édition française de son ouvrage de 1989, David Irving note “En 1934, Goering codifia la chasse dans le Reich”. Dans un ouvrage reposant sur une documentation remarquable, H. Rubner (p 78 etc) montre le rôle primordial exercé par U. Scherping, grand praticien de la chasse, fondateur en 1928 de l’Union de la chasse du royaume à Dresde (80000 adhérents en 1930). Casque d’acier en 1931, membre du parti le 1° mai il est chargé par Göring de l’élaboration de cette loi qui déplaît au Führer, constamment vaincu par le clan des enragés chasseurs que sont de nombreux dignitaires SS. (p. 172). La loi de chasse du 3/7/1934 regroupe bien des données antérieures et dispersée, mais elle est fort admirée hors d’Allemagne et imitée jusqu’à nos jours. Le même chercheur montre les difficultés soulevées par une première proposition d’une loi de protection de la nature par Mitzschke, 15/1/1935, p. 82) puis par von Keudell et l’effort déployé pour conserver quelques acquis précédents. Rubner souligne l’ambiguïté des options de Göring à cet égard, le domaine du satrape de Schorfheide constitue la vitrine d’une nature qu’il ne se gêne pas pour piller; il exclut rapidement du ministère les partisans d’une protection véritable Si ce court résumé est bien loin d’épuiser la complexité révélée par le remarquable travail de Rubner, il suffit cependant à montrer que la réalité des faits n’a aucun rapport avec les données imaginées par L. Ferry comme bases de sa théorie.
25Emule de Bottero, L. Ferry use d’une boursouflure documentaire des chiffres, comme si leur gigantisme imaginaire ajoutait à la véracité de l’affirmation. Sous sa plume, la loi du 24/11/1933 est “gigantesque (180 pages)”. Cette affirmation, répétée à l’identique à chaque publication, démontre que cet auteur n’a pas feuilleté le Commentaire de Giese et Kahler de 1939, dont il publie le début, jusqu’aux pages 262 à 268 où s’étale, sur 6 pages, la loi du 24/11/1933, au terme d’un commentaire de quelque 300 pages (et non de 180). Le Journal Officiel du Reich la publie sur à peine deux pages et demi. On constate que, cependant, ce procédé impressionne : J. F. Six rapporte ces faux chiffres (180 p.) à lettre, les faisant siens en les citant sans guillemets. Ces chiffres erronés montrent que L. Ferry, une fois de plus, confond le commentaire de Giese avec la loi, faute, sans doute, de savoir que le genre juridique du Kommentar est depuis longtemps apprécié en Allemagne, en raison même du caractère abstrait du droit germanique . On y déploie un subtil langage juridique, grâce à des phrases de 25 lignes et à de multiples constructions emboîtées. Cependant, les bibliographies accompagnant ces monuments juridiques allemands, contrairement à leurs émules made in USA, (600 pages sur le droit de l’animal toujours selon Ferry, 1992, p. 80.) sont hélas privées des deux zéros américains; ils “limitent” leur bibliographie à quelques pages serrées, incluant des ouvrages généraux et, parfois, de la jurisprudence. Au concept d’immensité numérique, Ferry ajoute l’immensité spatiale, typiques du système mythique: “Hitler est le premier au monde (souligné par nous) à publier une loi de protection de la nature aussi complète”, formule qui, on le verra, trouvera une postérité.
26Sur le point le plus dramatique du dossier, celui de la “vivisection”, L. Ferry se montre plus prudemment allusif que Nerson, mais plus précis que Proctor. Dans son livre de 1992, L. Ferry ne fait qu’évoquer la prétendue substitution de l’homme au cobaye (p.184): “l’alliance de la zoophilie la plus sincère n’en est pas restée aux paroles, mais s’est incarnée dans les faits”. Il ne donne qu’oralement, dans ses interviews divers, la clef de cette révélation, ultime et terrifiante conséquence de la protection de l’animal. La réglementation sur l’expérimentation animale du 24/11/1933 contredisant quelque peu la prétendue suppression de la vivisection, Luc Ferry en souligne un aspect qu’il croit novateur (1994, p. 506): … (par L’interdiction de la vivisection sans anesthésie, la loi nazie se montre) “en avance de cinquante ans (et même plus) sur son temps” ; nous avons donné plus haut les références de quelques-uns des plus éminentes réglementations antérieures qui permettent de constater la pauvreté absolue d’une telle déclaration.
27Une fois encore, en reproduisant ces paroles de Giese: “Ce n’est pas l’intérêt de l’homme qui serait ici l’arrière-fond: il est reconnu que l’animal doit être protégé en tant que tel (wegen seiner selbst)”, Ferry prend le commentaire pour un texte législatif, sans regarder qu’à quelques pages de là, le même commentateur détaille la notion d’utilité, de la souffrance animale, pour l’homme; loin d’être assassiné par les nazis, comme le proclame L. Ferry, l’anthropocentrisme sort renforcé de la législation du 24/11/1933, à laquelle Luc Ferry lui-même adhère, sans le savoir, mais explicitement, lorsqu’il recommande d’éviter des “souffrances inutiles” à l’animal! (1998, p. 75). Parmi de nombreux commentaires juridiques de l’époque nazie démontrant la soumission juridique de l’animal à l’homme, (évidemment aryen), il suffit ici de citer la thèse d’Albert Lorz C’est un point tout à fait élémentaire de la morale, écrit-il, que l’homme puisse user et abuser de l’animal à ses propres fins. Il faudrait pouvoir ajouter: “utiliser et sur-utiliser” pour rendre l’expression des deux paires de verbes allemands synonymes et consonnants: benutzen und abnutzen, brauchen und verbrauchen, chaque second terme marquant une dégradation supplémentaire. Cette conception de l’animal comme simple propriété, proche du droit romain, inviterait, dans une plus longue discussion, à nuancer une trop simpliste opposition entre une tradition nordique prétendue favorable à l’animal et une zone aussi ensoleillée que cartésienne. Quant à la prétention nazie de protéger tous les animaux, y compris les sauvages, dans laquelle L. Ferry voit un danger pour l’humanisme et l’humanité, qu’il se rassure: un simple coup d’œil sur la liste des “nuisibles” chassables en toutes circonstances ou sur les “plus basses espèces” à privilégier dans l’expérimentation animale, suffit à la démentir; la loi du 24/11/1933 ne traite pratiquement que d’animaux domestiques; c’est une fanfaronnade nazie de plus, que confirmerait une plus ample analyse; c’est hors de l’Allemagne nazie qu’on cherche des solutions pour y parvenir, notamment dans la patrie d’un disciple de Descartes, l’Espagne!
Le travail sur la frontière entre les humains et les animaux dans l’Allemagne nazie
Arnold Arluke Clinton R. Sanders*
» Afin que la torture des animaux ne continue pas je vais envoyer dans des camps de concentration ceux qui pensent encore qu’ils peuvent continuer à traiter les animaux comme une propriété inanimée. » (Hermann Goring, émission de radio, 1933)
II est bien connu que les nazis traitaient les êtres humains avec une extrême cruauté. Les terrifiantes expérimentations » médicales » sur les humains ont été soigneusement documentées et analysées1, de même que l’extermination froide et calculée de millions de personnes durant l’Holocauste2. On connaît moins les mesures pourtant considérables adoptées par les nazis pour assurer les soins et la protection des animaux. Bien sûr d’autres sociétés ont manifesté un certain mépris pour les humains alors même qu’elles témoignaient d’une attention marquée pour les animaux, mais le degré avec lequel les humains ont été brutalisés et les animaux idolâtrés dans l’Allemagne nazie fait paraître, en comparaison, les
* Extrait de Arluke (A.), Sanders (O), Regarding Animals, Philadelphia, Temple University Press, 1996. Traduction de N. Dodier.
Politix. Volume 16 – n° 64/2003, pages 17 à 49
Quand le Troisième Reich préférait les animaux aux hommes
On a coutume de dire » qui n’aime pas les bêtes n’aime pas les gens « , peut-être, mais ce qui est sûr, c’est que la réciproque n’est pas vraie.
L’histoire est remplie d’exemples de tyrans sanguinaires capables de s’attendrir devant des animaux, voire leur donner une place qu’ils n’accordaient pas à leurs semblables. Alors qu’on célèbre le 8 mai 1945, souvenons-nous de ces images montrant Hitler caressant son chien bien aimé, une femelle berger allemand nommée Blondi (à qui il fit avaler une capsule de cyanure avant de se suicider), ou les chiens de sa compagne Eva Braun. Pour lui, et plusieurs nazis de son entourage proche, les chiens étaient presque aussi intelligents que les humains, en tout cas beaucoup plus que les Juifs, Tsiganes ou autres ethnies. Hermann Göring, artisan de la » solution finale « , était considéré comme le principal défenseur des animaux, responsable d’un ministère des eaux et forêts qui fit beaucoup avancer la cause animale en dénonçant la vivisection par exemple, alors que, dans le même temps, d’infâmes » docteurs » pratiquèrent d’épouvantables expériences sur des êtres humains. Hitler, dans sa folie, était persuadé qu’on pouvait apprendre à parler, ou du moins à communiquer, aux chiens. Dès 1930 avait été créée une école où furent entraînés, après sélection, des chiens qui devinrent capables de taper sur des lettres pour constituer une phrase et répondre à des questions. L’idée directrice était de constituer une armée de » chiens parlants » affectés aux côtés des SS, notamment dans les camps de concentration, afin de délester les soldats de certaines tâches.